Prévenir et lutter contre les discriminations : des enjeux anciens et des défis toujours présents
Force est de constater qu’il n’y a toujours pas une véritable prise en compte de l’ampleur des discriminations et de leurs impacts. Claire Hédon, Défenseure des droits, rappelle que la lutte contre les discriminations n’est pas un simple objectif de politique publique parmi d’autres :
« Elle constitue le socle de ce que l’État doit à chacun de ses habitants pour former une société solidaire de personnes libres, égales et dignes »
La difficulté majeure réside dans l’absence d’une politique publique effective. Les indignations régulières s’agissant des discriminations vécues ne suffisent pas pour porter un réel projet politique visant à réduire les discriminations. Si l’approche politique reconnaît effectivement l’existence des discriminations, elle les renvoie, le plus souvent, à des comportements individuels sans reconnaître leur dimension systémique.
Aussi, l’approche par la politique de la ville interroge à la fois, la fonction effective des politiques publiques dans la lutte contre les discriminations et la capacité d’agir des professionnels de la politique de la ville face aux discriminations. Le paradoxe est que, l’action locale, via notamment la politique de la ville, reste encore un des seuls moyens d’accompagner les professionnels pour faire face aux processus discriminatoires afin de construire des réponses localement.
Plaidoyer pour une véritable politique publique de la non-discrimination
Les éléments mis en avant dans ce numéro de la revue nous donnent autant de leviers pour demain afin d’élaborer et de mettre en œuvre réellement une politique publique de la non-discrimination en faveur de l’égalité.
Le défi, dans un contexte où le lien social et le lien à la communauté nationale sont mis à mal, est de se doter d’une véritable politique publique reconnaissant la dimension systémique des discriminations et déployer une approche intégrée. Cela passe notamment par une culture de l’égalité qui interroge les pratiques professionnelles des secteurs publics et privés.
Plusieurs conditions récurrentes émergent de ce numéro :
-
une réelle impulsion politique (locale notamment) et un Etat agissant sur l’action publique,
-
la conception d’un cadre d’action stratégique (et pas seulement d’un plan),
-
une capacité d’animation de la stratégie reposant sur des moyens humains (acteurs qualifiés et disposant de ressources),
-
une reconnaissance des premiers concernés comme partenaires des politiques publiques à développer.
Un numéro qui alerte autant qu'il donne à voir des mobilisations inspirantes
L'entretien de Claire Hédon, Défenseure des droits ou l'article de Lanna Hollo et Myriame Matari "La politique de la ville : un pis-aller face à la persistance du problème des contrôles au faciès ? " nous éclairent quant aux enjeux à porter s'agissant des minorités racisées au sein des QPV. Ils rejoignent aussi des mobilisations qui visent à éclairer aux échelles locales par l'article de Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin "Mesurer le sentiment de discrimination" par des enquêtes de victimation". Pour ce nouveau numéro, le réseau RECI a recueilli ainsi des textes de professionnels, d'universitaires et d'institutions qui prennent en charge les questions de LCD afin d'interroger les contours de cette lutte dans la politique de la ville. L'expertise du réseau RECI a permis de mobiliser des contributeur.rice.s de grandes qualités capables de porter des enseignements forts pour la politique de la ville ainsi que des leviers de mobilisation.
Retrouvez la vidéo de présentation de ce nouveau numéro :
CAHIERS 20 2/3
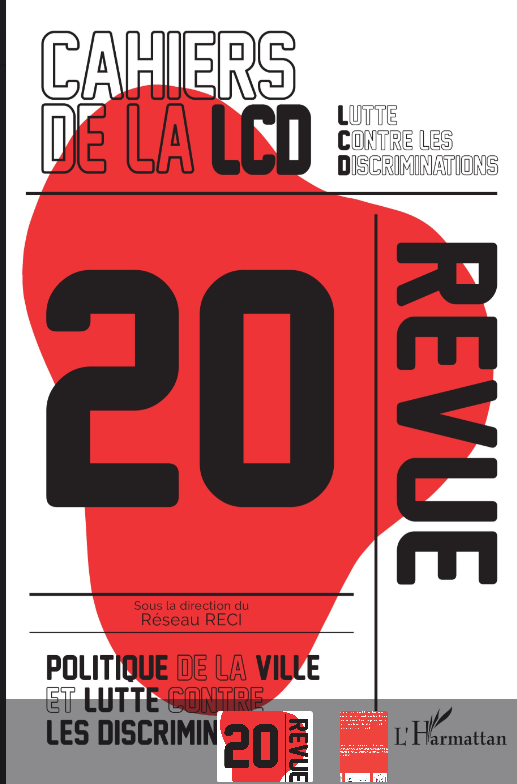
Ce numéro est disponible à la commande ici
Le réseau RECI remercie vivement les co-directrices des cahiers de la LCD pour cette collaboration de qualité et pour la confiance accordée.